Pachinko
«Isak prit la main de son fils dans la sienne.
– Tu es très courageux, Noa. Bien plus que moi. Il faut faire preuve d’une grande bravoure pour vivre chaque jour en présence de ceux qui refusent de reconnaître ton individualité.»
— Min Jin Lee, Pachinko
D’exilé à apatride, il n’y a qu’un pas. Lorsque je doute de mes connaissances lexicales, c’est dans le Littré que je plonge. J’y trouve une fondation étymologique et littéraire à la définition proposée et retenue par le dictionnaire du vocable qui m’intéresse. Je peux y saisir davantage de nuances, parfois très subtiles, entre plusieurs mots. Par exemple ici, si exil renvoie à une expulsion hors de sa patrie, apatride fait référence à un refus administratif d’une ou de plusieurs nations dont se réclame un ressortissant d’accepter ce dernier comme membre de la patrie du point de vue règlementaire. Ainsi, l’exil ne résulterait pas d’une décision étatique et administrative.
S’exiler volontairement est un euphémisme regrettable qu’il conviendrait de combattre, tant la question identitaire individuelle peut s’avérer centrale et douloureuse lorsqu’on fait l’expérience de l’exil volontaire, mais aussi protéiforme à mesure qu’elle se transmet de génération en génération.
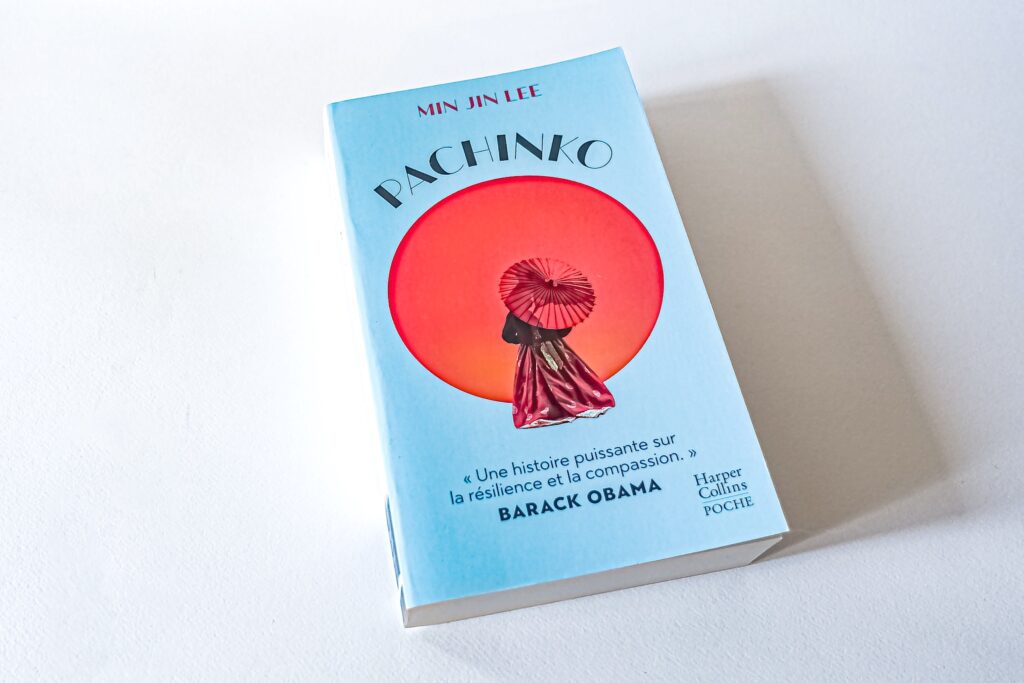
Et Pachinko en est une illustration riche, déchirante et transgénérationnelle, qui m’a permis non seulement d’interroger mon rapport à l’histoire européenne et ses multiples chapitres de flux migratoires, de découvrir un pan important de l’histoire japonaise et coréenne, que je n’ai jamais eu l’opportunité d’étudier lors de ma scolarité en France ou en Europe, et de m’interroger à froid sur l’histoire de mes grands-parents paternels, ayant quitté le Portugal dans les années 1960 pour tenter d’offrir une vie meilleure à leurs enfants en France. Jusqu’alors je ne les avais jamais considérés comme des exilés. Et Pachinko m’a conduite à me poser la question avec cette nouvelle lumière.
Si le déclencheur de l’exil conté dans ce livre est une situation d’une effroyable banalité, que ce soit à travers les âges, les géographies ou les cultures, la suite de l’histoire impacte avec une pesanteur asphyxiante trois générations avant que le lecteur ne puisse imaginer qu’une étincelle déclenche un pivot identitaire dans la tête et le cœur de l’un des protagonistes. Sunja est le personnage principal de cette fresque qui traverse l’entre-deux guerres, la seconde guerre mondiale et nous conduit jusqu’aux années 1980 où Solomon, son petit-fils, semble sur le point de vivre un bouleversement identitaire, alors qu’il écoute son supérieur hiérarchique lui parler de son pays, le Japon, et de la vision qu’il en a au moment de leur échange.
Sunja, adolescente insulaire de Yeongdo en Corée, travaillant aux côtés de sa mère Yangjin dans la pension de son père décédé, se retrouve déflorée et enceinte d’un négociant énigmatique. Il travaille entre le Japon et la Corée et lui propose de devenir sa femme coréenne, promettant que ni elle ni leur enfant ne manqueraient de rien si elle acceptait la proposition.
Cet événement sur lequel repose tout le livre m’a permis très rapidement de saisir la majesté des cœurs des Coréen.ne.s. J’ai été émue et touchée coup sur coup lorsque Sunja refuse de déshonorer sa mère et son défunt père en devenant la femme coréenne d’un négociant un peu douteux. Inquiète du futur de sa fille, Yangjin demande à un pasteur, qui réside à la pension à ce moment-là, d’avoir une conversation avec sa fille. Originaire de Pyongyang, Isak Baek est de passage à la pension, suivant les pas de son frère aîné qui avait très apprécié sa rencontre avec le père de Sunja lors d’un de ses voyages. Il est en chemin vers Osaka au Japon pour rejoindre une congrégation de missionnaires protestants canadiens pour continuer à évangéliser les populations. Il cherche à y rejoindre son autre frère et sa belle-sœur, qui sont déjà sur place. Sa conversation avec Sunja le conduit à lui faire une proposition de mariage et à demander à cette dernière une conversion plus affirmée au protestantisme. Souffrant de tuberculose, il voit dans l’acceptation de Sunja de l’épouser la bonté du Seigneur. En effet, quelle adolescente voudrait d’un malade déjà condamné pour époux, même face à une grossesse survenant un peu trop rapidement dans la vie ? Cette union va cimenter la thématique de la survie d’une famille coréenne dans une société japonaise qui la rejette, lui laisse quelques miettes indésirables de l’économie parallèle, exige d’elle qu’elle renie ses croyances les plus salvatrices – les croyances spirituelles – et ne tolère quasiment pas sa vue. En témoignent les extraits suivants :
Le Japon était en crise ; le gouvernement le savait, mais refusait d’admettre la défaite. La guerre en Chine se poursuivait indéfiniment. […] Cela avait-il la moindre importance pour Yoseb ? Il opinait quand il fallait et marquait son approbation quand son patron japonais parlait de la guerre, parce que c’était ce qu’on attendait de lui. Pour autant, aux yeux de tous les Coréens de sa connaissance, la guerre du Japon qui s’étendait en Asie semblait absurde. […] Les Coréens parviendraient-ils à tirer leur épingle du jeu ? Vraisemblablement pas. Il fallait sauver sa peau – c’était l’intime conviction des Coréens. Protéger sa famille. Remplir son ventre. Rester vigilant et se méfier des gens au pouvoir. […] Au bout du compte, l’estomac était roi.
Tous ces gens – les Japonais et les Coréens – sont de la merde parce qu’ils pensent en termes de groupe. Mais je vais te dire la vérité : un leader bienveillant, ça n’existe pas. […] Alors, je ne vais pas t’interdire d’aller à ces réunions ou de rejoindre un parti. Mais sache ceci : ces communistes n’en ont rien à faire de toi. Ils n’en ont rien à faire de personne. Tu serais naïf de croire qu’ils ont les intérêts de la Corée à cœur.
– Parfois j’aimerais revoir ma patrie, dit doucement Kim.
– Pour les gens comme nous, la patrie n’existe pas.
D’ordinaire difficile à amadouer, Yumi admirait son professeur, que les élèves appelaient « pasteur John ». Pour elle, John incarnait le Coréen d’un monde meilleur où ils n’étaient pas assimilés à des prostituées, des ivrognes ou des voleurs. La mère de Yumi, une prostituée et une ivrogne, avait couché pour de l’argent et de l’alcool, et son père, proxénète et soûlard violent, s’était retrouvé plusieurs fois derrière les barreaux. À ses yeux, ses trois demi-sœurs aînées vivaient dans la même promiscuité sexuelle et vulgarité que des bêtes. […] Elle connaissait des Coréens qui étaient rentrés en Corée du Nord, et plus encore en Corée du Sud, pourtant elle n’éprouvait aucune affection pour l’un ou l’autre de ces États. Pour elle, ses racines coréennes n’étaient qu’un poids de plus, comme celui de la pauvreté, ou de sa famille honteuse dont elle ne pouvait se débarrasser.
Noa n’en revenait pas. Elle le verrait toujours non pas pour ce qu’il était vraiment, mais pour l’idée exotique qu’elle se faisait d’un étranger ; elle se sentirait toujours fière d’elle pour avoir consenti à être avec un homme que le reste du pays détestait. Sa présence prouvait au monde qu’elle était une belle personne, cultivée, tolérante.
– Il n’y a rien à faire. Je ne peux pas changer son destin. Il est coréen. Il doit obtenir ces papiers, il doit suivre la loi à la lettre. Une fois, pour un renouvellement, un fonctionnaire m’a dit que je n’étais qu’un invité dans son pays. […]
– Solomon et toi êtes nés ici. […]
– Quoi qu’il en soit, ce fonctionnaire n’avait pas tort. Et c’est quelque chose que Solomon va devoir comprendre. Nous pouvons être déportés du jour au lendemain. Nous n’avons pas de pays d’origine. La vie est faite d’aléas incontrôlables, alors il faut s’adapter. Mon fils doit apprendre à survivre.
Avec un tel terreau, Min Jin Lee enrichit son récit par l’épaisseur qu’elle donne à l’ensemble de ses personnages. Alors que j’écris cette chronique, il me semble si logique et si limpide que les relations entre eux aient pu être par moments si difficiles. Toutes et tous souffrent de l’histoire de Sunja. Et pourtant le groupe reste soudé et solidaire, courbe l’échine pour se nourrir, se soigner, survivre pendant la guerre avec un coup de pouce du mystérieux négociant – yakuza en réalité. Sunja n’est pas épargnée par les conséquences du choix majeur qu’elle a fait dans sa vie lorsqu’elle décide de garder le bébé de son premier amour, celui qu’elle regarde avec la passion déraisonnée et illustrant la naïveté typique d’amour d’adolescentes. Raconter la passion adolescente n’est pas forcément chose intuitive et je trouve la délicatesse de l’autrice à la hauteur de l’intensité de ce qu’a pu ressentir probablement Sunja, dont je vous livre quelques exemples.
« Elle se serait déracinée pour voir le monde avec lui, et maintenant elle le voyait sans lui.
Elle avait aimé ses traits comme la clarté de la lune et le bleu de la mer.
Oui, la vie à Osaka serait difficile, mais les choses allaient s’arranger. Ils feraient un bouillon heureux des cailloux et de l’amertume qu’on leur donnait.
En réponse à cette passion dévorante qui conduit l’adolescente à l’exil, remplissant son quotidien d’une pratique de la résilience sans précédent, qu’elle exerce d’ailleurs avec une endurance indescriptible pour traverser la vie choisie, il y a deux altercations qui se miroitent et quelque part se répondent en la personne de Sunja elle-même. Face la colère qui finit par dégouliner de la bouche de sa mère, Sunja refuse d’en vouloir à cette dernière, malgré la dureté de ses propos. De nombreuses années avant que ce conflit ne survienne, Noa vient confronter sa mère lorsqu’il comprend qui est son père et quelle est sa profession. Au cours de cette altercation, Min Jin Lee nous transmet sans ambiguïté aucune le lourd ressentiment que traîne Noa dans son cœur depuis si longtemps. L’autrice nous communique les émotions avec une intensité non contenue et que j’ai trouvée particulièrement émouvante. Pour moi, se dire ce qu’on a sur le cœur est un exercice régulièrement inconfortable pour l’humain.e, notamment lorsque le message à transmettre et/ou recevoir est inconfortable, malgré les bienfaits du dialogue connus de tous.tes. Je vous laisse découvrir l’échange entre Yangjin et Sunja pour commencer puis entre Noa et sa mère.
« – Go-saeng, dit Yangjin. Le destin d’une femme est de souffrir. […]
Toute sa vie, Sunja avait entendu cet adage martelé par les femmes. Elles devaient forcément vivre dans la souffrance – en tant que fille, en tant qu’épouse, en tant que mère – et mourir dans la souffrance, tel était leur destin. Go-saeng … ce mot lui filait la nausée. Y avait-il une autre voie que l’endurance ? Elle s’était saignée pour offrir une vie meilleure à Noa, et pourtant ça n’avait pas suffi. Il avait fini par refuser de subir les conditions de sa naissance. Au lieu de se sacrifier, aurait-elle dû apprendre à son fils à supporter l’humiliation qu’elle-même avait absorbée comme de l’eau ? Était-ce l’échec d’une mère que de ne pas préparer son fils aux épreuves qui l’attend ? […]
– Tu as condamné ton enfant à la honte en lui donnant cet homme pour père. Tu as causé ta propre souffrance. Ce pauvre garçon est né d’une mauvaise graine. Tu as de la chance qu’Isak t’ait épousée. Cet homme était une bénédiction. Mozasu vient d’un meilleur sang. C’est pour ça qu’il est béni dans son travail.
Sunja se couvrait la bouche des deux mains. On disait souvent que les vieilles femmes parlaient trop pour ne rien dire, mais sa mère semblait au contraire avoir des opinions bien précises en réserve pour elle. Comme un héritage mesquin qu’elle aurait prévu de lui transmettre au dernier moment. Sunja ne pouvait pas la contredire. À quoi bon ? […]
– Si Noa n’avait aucune chance, alors dans ce cas pourquoi ai-je tant souffert ? À quoi bon même faire des efforts ? Si je suis si naïve, si j’ai commis des erreurs impardonnables, est-ce que c’est par ta faute ? Je ne peux pas … je refuse de t’en vouloir. […]
Sunja regarda Kyunghee caresser doucement sa mère pour la calmer. Elle était méconnaissable.On aurait pu blâmer la maladie pour cette métamorphose, mais n’étais-ce pas illusoire ? L’agonie n’avait fait que révéler les pensées les plus sincères de sa mère, celles dont elle l’avait protégée. Sunja avait fait une erreur, pour autant elle ne pensait pas que son fils était né d’une mauvaise graine. Les Japonais disait des Coréens qu’ils avaient la colère et le feu dans le sang. La semence, le sang. Comment lutter contre des idées si fatalistes ? Noa avait été un enfant sensible qui avait cru qu’en suivant toutes les règles et qu’en faisant de son mieux, ce monde hostile changerait d’avis sur lui. Finalement, elle avait peut-être une part de responsabilité dans sa mort, pour l’avoir laissé croire en de si cruels idéaux
– Tu sais que c’est un yakuza ? Est-ce que c’est vrai, ça aussi ?
– Non, non. Je ne sais rien de tout ça. Je ne sais pas ce qu’il fait. […]
– Les yakuzas sont ce qu’il y a de plus pourri au Japon. Des mafieux, des criminels. Ils intimident les commerçants, vendent de la drogue, contrôlent la prostitution et s’en prennent aux innocents. Ces gangs sont composés de la vermine de la Corée. J’ai accepté de l’argent d’un yakuza et tu trouves ça acceptable ? Jamais je ne pourrai laver mon nom. Tu ne dois vraiment pas être une lumière si tu espérais rendre propre quelque chose de souillé. C’est moi que tu as sali.
Noa parlait doucement, comme s’il prenait conscience des choses au moment même où il les énonçait.
– Toute ma vie, j’ai entendu des Japonais me dire que les Coréens sont des gens agressifs, violents, fourbes, et des criminels sournois. Toute ma vie, j’ai dû l’endurer. Je voulais devenir aussi honnête et humble que Baek Isak ; jamais je n’ai haussé le ton. Pire que le sang coréen, maintenant j’apprends que coule dans mes veines le sang d’un yakuza. Je ne pourrai jamais changé cela, rien n’y fera. Il aurait mieux valu que je ne sois jamais né. Comment as-tu pu gâcher ma vie ainsi ? Comment as-tu pu te montrer aussi imprudente ? Une mère stupide et un père criminel. Je suis maudit.
[…] Il y avait des organisations criminelles partout, supposait-elle, et elle savait qu’elles commettaient des atrocités, mais elle savait aussi que beaucoup de Coréens travaillaient pour ces organisations parce qu’il n’y avait pas d’autres boulots pour eux. Le gouvernement et les entreprises respectables refusaient de les engager, même ceux qui avaient fait des études.
Après que Sunja et Noa ont fait chacun.e de leur mieux pour vivre avec l’exil, c’est en la personne de Solomon, le neveu de Noa et fils de son petit frère Mozasu, que se fonde l’espoir d’un salut pour cette famille coréenne et celui d’une vie sur laquelle l’exil n’aura plus de conséquences néfastes. Voici le dernier extrait que je souhaite partager avec vous avant de conclure cette chronique sur Pachinko :
« – OK, monsieur le dur à cuire, dit Kazu. Écoute, il y a une taxe sur la réussite, tu sais.
– Hein ?
– Dans n’importe quel domaine, si tu réussis, tu dois passer à la caisse pour tous ceux qui s’en sortent moins bien. À l’inverse, si tu te foires, la vie te fait payer une taxe de merde aussi. Tout le monde finit par payer quelque chose.
Kazu le regardait très sérieusement.
– Bien sûr, la pire de toutes, c’est la taxe sur la médiocrité. Celle-là est vraiment perverse. […]
– Alors, la taxe sur la réussite, c’est la jalousie, et la taxe de merde, c’est l’exploitation. OK. Mais pour la taxe de la médiocrité. Où est le mal dans …
– Très bonne question, jeune Padawan. La taxe sur la médiocrité, c’est la conscience – la tienne et celle de tous les autres – de ta banalité. C’est une taxe plus lourde que tu ne l’imagines. […]
– Jedi, comprends ceci : il n’y a rien de pire que de savoir que tu es comme tout le monde. C’est la promesse d’une vie ratée et plate. Et au sein de cette grande nation qu’est le Japon – la terre qui a vu naître tous mes nobles ancêtres -, tous, absolument tous ne veulent qu’une chose : être comme les autres. C’est pour ça que c’est un coin si tranquille, un vrai village de dinosaures. C’est l’extinction, mon gars. Taille-toi une part du gâteau tant que tu peux, et va investir ton butin ailleurs. Tu es encore jeune, et il faut bien que quelqu’un t’ouvre les yeux sur ce pays. Ce n’est pas parce qu’il a perdu la guerre ou qu’il a fait des erreurs que le Japon est dans la merde. C’est parce que la guerre est terminée, et qu’en temps de guerre, tout le monde aspire à la médiocrité et tremble à l’idée de se démarquer. C’est aussi parce que l’élite japonaise rêverait d’être anglaise et blanche. C’est pathétique, naïf, et c’est un tout autre sujet.
Alors apatride ou exilé ? Si personne n’était là, comme Min Jin Lee, pour raconter le poids du rejet social dont va souffrir cette famille coréenne au Japon, et du poids du possible rejet social qui pourrait être rencontré dans la patrie d’origine si elle rentrait de son exil, alors l’humain social manquerait cruellement de lumière pour réaliser qu’une telle expérience marque les générations futures d’une même famille presque dans la chair. Ainsi, que l’une ou l’autre des Corées ne rejette pas administrativement ses ressortissants ne crée aucune différence pour les exilés qui ne reviennent pas. C’est en cela, qu’en réfléchissant à cette chronique, j’ai considéré Sunja et sa tribu comme équivalents à des apatrides.
Si la neuroscience a pu montrer que la douleur ressentie en cas de rejet social active les mêmes zones du cerveau qu’en cas de douleurs physiques, alors je ne peux que réaliser à quel point connaître son identité et se l’approprier est un enjeu vital dès lors que l’individu se retrouve en capacité et ressent le besoin de socialiser. Qu’il me tarde d’explorer la littérature nord-africaine (pour les conséquences de la colonisation) ou indienne (pour la hiérarchie sociale et les limites quasiment inamovibles qui lui sont liées), pour continuer à aiguiser ma compréhension de l’identité, de l’exil ou tout autre élément constitutif de l’individu, au détour d’un voyage littéraire, culturel, historique, et avant tout merveilleusement enrichissant.
Bonne lecture !
Vous souhaitez lire ce livre ?

Bonjour, ceci est un commentaire.
Pour débuter avec la modération, la modification et la suppression de commentaires, veuillez visiter l’écran des Commentaires dans le Tableau de bord.
Les avatars des personnes qui commentent arrivent depuis Gravatar.